C’est fou ça. Ce besoin, toujours, d’aller voir ce qu’il y a derrière, plus haut, plus loin, de l’autre côté des choses. C’est ce qu’on fait tous, depuis la gamine, deux ans, qui met le chaton dans sa casquette, les doigts dans sa culotte et les cailloux dans sa bouche au scientifique dans son labo qui, entre deux demandes de subventions,essaie d’évaluer quel degré d’intelligence il y a dans la tête du corvidé en face de lui, derrière les barreaux. Ne parlons pas d’ Armstrong (oui, celui qui est réellement allé sur la lune), des invasions mongoles, du truc qui te pousse à finir ton livre et ton assiette même si c’est pas bon ou de ma mère en randonnée, activiste détestée du : plus haut c’est plus beau.
Moi, je me demande toujours ce qu’il y a derrière les murs.
Nous avons eu la chance récemment de voir plusieurs villes du dessus, enfin des petits bouts bien sûr, depuis le réseau téléphérique ultramoderne de la Paz à la terrasse sur le toit de notre hôtel actuel à Santa Cruz. C’est incroyable tout ce qu’on découvre derrière les murs. En briques rouges ou colonnades blanches, toujours des cours carrées entourées de pièces carrées dans un ensemble de « quadros » construits depuis le bas (c’est mieux…) toujours immédiatement habité vers les étages, deux ou trois, souvent vides, jamais achevés, toutes tiges à l’air, alors que la ville continue de s’étaler inexorablement autour de sa place centrale carrée. Dans les cours, des bars animés, un arbre superbe au milieu de salles à l’abandon, quelques chaises… Le plus souvent un débarras, amas de pneus, de tôles, de planches dont on se servira un jour ou l’autre. Vue sur les terrasses aussi : beaucoup de bassines à moitié remplies d’eau plus ou moins propres, un gamin qui frotte son pyjama, la lessive qui trempe. Deux, trois chiens qui tournent en rond en se jappant vaguement des trucs d’une rue à l’autre. Tout un monde insoupçonnable d’en bas.
La misère, elle, s’expose bien sur les trottoirs. Difficile de passer à côté, pourtant c’est exactement ce qu’on fait. On passe à côté. En plus elle pue la misère, à plein nez, une odeur agressive, suffocante de vieille pisse et de crasse dans le pire des cas, une odeur rance de sueur dans les transports de travailleurs au coude à coude de la pauvreté plus discrète, quotidienne, normale. Et faut voir les gueules qui vont avec.
Quoi ? J’ai pas le droit de dire que les pauvres puent ? J’y peux rien si c’est vrai. Elle est là l’hypocrisie, quand on s’indigne des mots au lieu de s’indigner des choses.
Les pauvres ne sont pas derrière les murs. Derrière une vague paroi collection bois et tôle à la limite. Être pauvre ce n’est pas préparer à manger au feu de bois dans ta cuisine, faire la vaisselle à l’eau du fleuve ni même te laver les dents une lampe accrochée au dessus du miroir dans ta cour. Ça c’est juste la vie.
Etre pauvre c’est quand personne ne veut de toi, quand on ne veut ni te voir, ni t’avoir pour voisin. Ici les pauvres ce sont les indigènes jetés à la périphérie des villes qu’ils ont eux même construits sous les fusils espagnols. Les pauvres ne sont pas derrière les murs ils sont juste à leurs pieds.
Beaucoup de mendiants donc, sur les trottoirs, de mendiantes bien sûr, pas de problèmes de mixité dans ce domaine, des enfants qui passent entre les tables des cafés pour vous vendre un paquet de chewing-gum, entre les sièges des bus pour une bouteille d’eau.
J’ai dit (en espagnol) :
« -Comme ils sont jeunes.
Mon voisin m’a répondu (en espagnol): – C’est l’Amérique latine. S’ils ne travaillent pas, leur famille ne mangera pas et eux non plus. J’ai commencé à travailler à 8 ans.
J’ai dit (valable dans toutes les langues): – Ah. »
Il n’avait pas l’air traumatisé. En Bolivie, l’âge légal a été abaissé par Evo Morales à 10 ans. Nous, moi, européen ne trouvons pas ça bien, est-ce que c’est mieux de crever de faim ? Est-ce que c’est vrai? Aujourd’hui, on peut encore crever de faim? Aujourd’hui on doit encore choisir entre manger et aller à l’école ?
Dans la rue, on apprend sûrement des choses qu’on n’apprendra pas à l’école. À l’école, on apprend à coup sûr des choses qu’on n’apprendra jamais dans la rue.
J’ai entendu une bolivienne dire (en espagnol) le célèbre « Quand on veut on peut. ». Ça me parait méchamment optimiste. A la limite on peut se mettre d’accord que quand on ne veut pas on ne peut pas mais pour le reste…
C’est sûr que c’est mieux d’essayer de s’en sortir tout seul plutôt que d’attendre que ça tombe.
Ça ne tombera pas.
Ce qui est en haut reste en haut, c’est la loi anti-gravité écrite nulle part et sue partout, par tous, les cireurs de chaussures de la place centrale sur leurs trônes devant lesquels ils s’assoient ou s’inclinent tour à tour, les balayeurs-éboueurs en combinaison intégrale fluo pour qu’on puisse s’éloigner de loin, les photographes imprimante en bandoulière qui font les cent pas devant les cathédrales, les vendeuses de bouteilles des feux rouges, les chauffeurs de taxi-moto à casquette, les livreurs de bancs et leurs plateaux, les glaciers des carrefours, les presseuses d’orange, les vendeurs tissu- trottoir, les laveurs de pare-brise, les magouilleurs…
Que chacun se prenne en main à défaut de celle des autres, et on pourra enfin s’acheter des Coca et Nestlé au lieu de se faire chier à filtrer l’eau du Rio pour la boire! On pourra faire péter le poulet dans l’huile où ont cuit les bananes!
J’aurais bien aimé interroger l’enfant aux chewing-gums mais il avait du travail et je suis qui pour lui dire quoi?
J’aurais bien aimé parler davantage à mon voisin mais il a mis ses écouteurs et j’ai eu peur de déranger.
J’aurais bien aimé aller voir plus loin, remonter le cours du fleuve pendant des jours sur une de ses barques chargées jusqu’à plus soif de bouteilles de coca, de bière, ou de gaz, les trois seuls ingrédients d’importation indispensables à la survie en forêt semble-t-il.
Ces radeaux remorqués par un bateau à moteur qui partent livrer les villages du fin fond de la forêt.
Cette forêt qui leur fournit gratuitement tout le reste et qu’on coupe pour éviter ça.

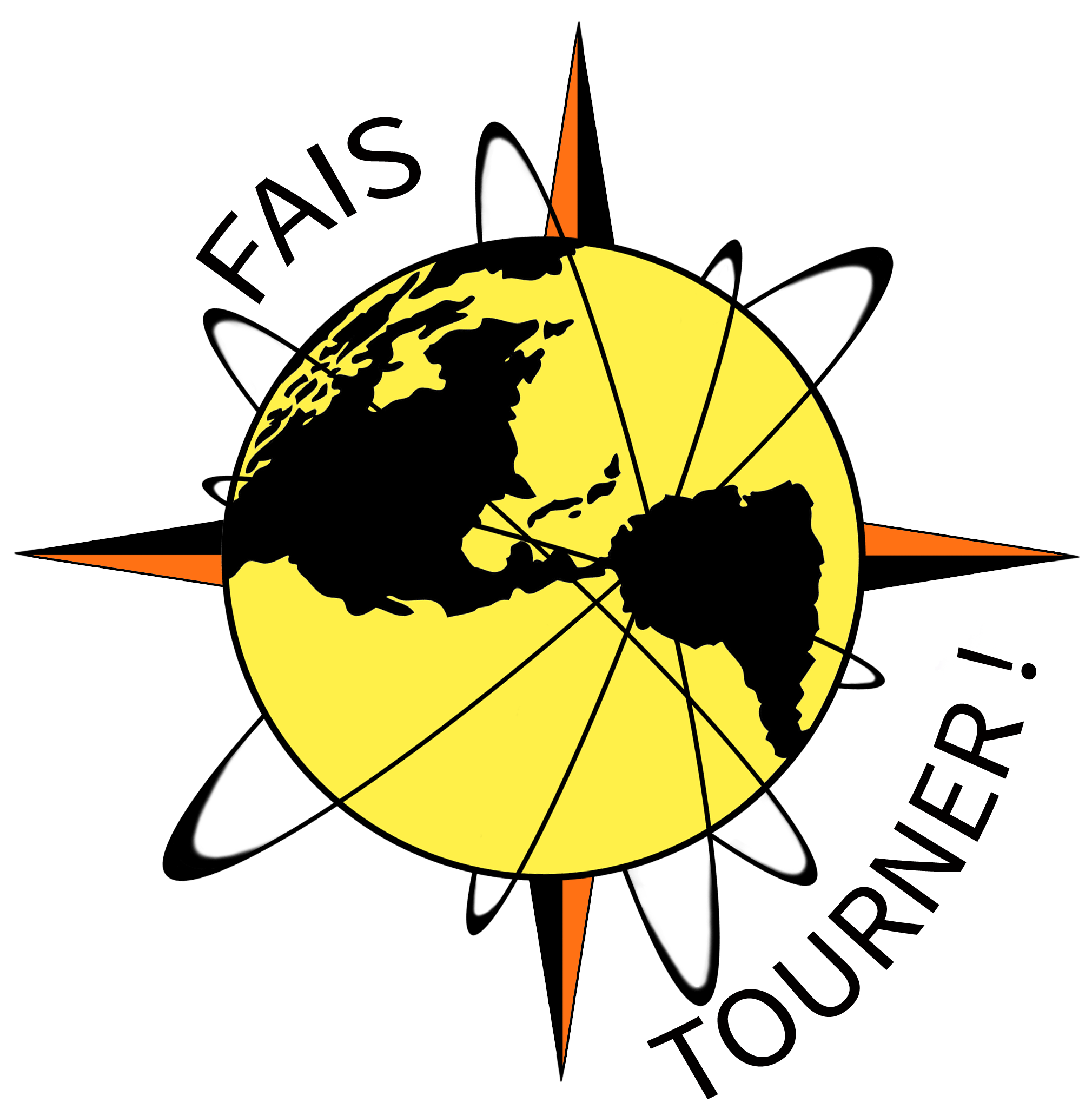








Super texte, un de tes meilleurs je trouve. Ton « l’hypocrisie c’est de s’indigner des mots et non pas des choses » me fait réfléchir depuis 5 min.
Beaucoup de pauvreté en Bolivie en effet mais c’est pas là où ça m’avait le plus marqué. Faut dire qu’on avait commencé notre voyage en Afrique de l’Ouest, on avait déjà affronté la misère. On en ressort finalement avec beaucoup d’humilité, ces gens sont des héros du quotidien, leur vie est bien plus dure que la nôtre et pourtant beaucoup autour de nous se plaignent à longueur de journée.
Et pour les photos, superbes comme d’habitude, j’ai aimé vous voir à Tihuanaco et à Copacabana, je ne connaissais pas Santa Cruz ni l’Amazonie bolivienne. Très chouette voyage que vous faites en ce moment…
Ah enfin je confirme, Elsa ta nouvelle coupe te va très bien 😉
NB:(Note à Benet): y a pas que les randonneurs qui veulent monter trop haut, chez les voileux “plus c’est haut, plus c’est beau” veut dire que le vent est tjrs plus fort en haut du mat! et chez les escargots et les architectes, je te raconte pas…
J’aime beaucoup ton texte,
Savoir derriere les murs et les mots ce qu’on ne veut plus voir!
Eloigner, cacher, nier jusque ds les mots des “novlangue”. Continuez à regarder ! et à nous dire…
Merci des trés jolies photos qui nous permettent de continuer le voyage…
Dérangeant et démoralisant cette pauvreté?…
Pays moins touristique, à explorer en immersion?…
Trop mignons les bébés Titane!
Merci de nous ouvrir à de nouveaux territoires.
Besitos, baci, bisous!